Ressources
Les biens immatériels
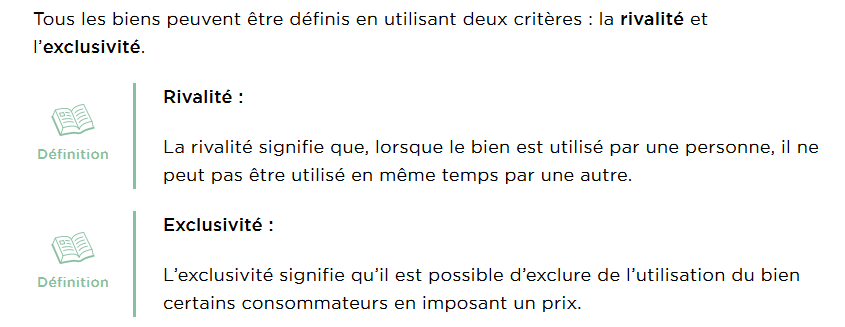
Les œuvres numériques (logiciels, images, sons, vidéos...) sont des biens dits « non rivaux » : leur utilisation par une personne n’empêche pas leur utilisation par une autre ; des millions de personnes peuvent ainsi accéder à une même vidéo sur youtube. Les biens matériels sont plus facilement rivaux : une voiture, un habit, etc..; quand les biens « rivaux » sont duplicables, ce qui permet d’en faire profiter d’autres personnes, cela à un coût.
Les biens numériques peuvent être matériels comme un CD de musique ou immatériels comme les fichiers sons extraits du même CD. La réalisation d’une copie est souvent aisée et peu coûteuse. Se pose alors le problème de l’économie d’un bien numérique. Notre système économique a été conçu initialement pour le commerce des biens rivaux : quelqu'un produit un bien, le distribue ou le fait distribuer, un client l’achète et en dispose. Il en va ainsi pour la nourriture, les vêtements, etc.
Le commerce d’un bien « non rival » comme un fichier audio est plus complexe, pour le producteur, il y a un coût de fabrication et peu de coût de duplication ce qui pourrait laisser envisager plus de profits, cependant la plupart du temps il est aisé de copier l’œuvre et de la mettre à disposition. Les consommateurs se demandent rapidement pourquoi payer si on peut obtenir le bien gratuitement ?
Aujourd'hui la question de la rémunération des acteurs de produits numériques est complexe et perfectible. Les solutions actuelles sont :
- L’accès aux contenus bloqué par péage (systèmes des télévisions à péage, les plateformes légales d’écoute de musique, de visionnage de vidéos, etc..) ,
- l’abonnement aux logiciels avec activation internet permet aux éditeurs de les protéger plus facilement contre la copie.
- les protections contre la copie « DRM » sur les supports matériels de type CD audio ou DVD, etc.
- la rémunération par la publicité ou par des services annexes (support, maintenance) ,
- les impôts ou taxes applicables aux supports de stockage ou aux abonnements internet.


Les droits d’auteur et de reproduction
Dans la législation française le texte qui réglemente la propriété intellectuelle est le Code de la propriété intellectuelle, qui date du 1er juillet 1992 et couvre deux domaines :
- Le droit d’auteur qui concerne les œuvres de l’esprit (littéraires, artistiques mais aussi les logiciels et les productions numériques).
- Le droit des brevets qui concerne les créations techniques et la propriété industrielle.
En Europe, les logiciels relèvent du droit d’auteur et non du droit des brevets (Convention de Munich de 1973), ce n’est pas le cas aux États-Unis. Microsoft a ainsi déposé des milliers de brevets et a attaqué en justice d’autres sociétés pour vols et emprunts de procédés brevetés.
La question de la brevetabilité des procédés logiciels est l’objet d’une bataille entre les éditeurs de logiciels. Le droit des brevets actuel ne fournit pas un cadre juridique adapté pour une activité comme la programmation qui nécessite l’utilisation de bibliothèques tierces qui peuvent contenir du code « propriétaire ». Si un contenu est protégé par un droit d’auteur ou le droit des brevets, la libre diffusion de ce contenu ne peut pas se faire sans l’autorisation de l’auteur ou du titulaire des droits sous peine d’incrimination de délit de contrefaçon.
Dans le droit français, le droit d’auteur se décline en deux volets :
- Les droits patrimoniaux (copyright du droit anglo-saxon) sont temporaires (70 ans après la mort de l’auteur l’œuvre tombe dans le domaine public) et cessibles, l’auteur possède :
- le droit exclusif d’exploitation et de distribution de l’œuvre,
- le droit de représentation (communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque),
- le droit de reproduction (une copie privée est concédée à l’acquéreur d’un logiciel).
- Les droits moraux (perpétuels et inaliénables) :
- droit de paternité : il implique que l’on doit citer l’auteur d’une œuvre qu’on représente ou reproduit.
- droit au respect de l’intégrité de l’œuvre,
- droit de divulgation : l’auteur peut décider quand il veut rendre publique son œuvre (on ne peut pas publier une œuvre avant son auteur).
Il faut noter que le droit d’auteur pour les logiciels a reçu quelques adaptations du droit d’auteur classique, par exemple les droits patrimoniaux sur un logiciel conçu par un salarié dans le cadre de son contrat de travail sont dévolus à son employeur. L’employé conserve cependant ses droits moraux.
Pour l’application du droit d’auteur aux logiciels et aux œuvres numériques, l’harmonisation des différentes législations nationales pose problème sur le plan international mais avance sur le plan européen (directive de 2001 sur les droits d’auteur dans la société de l’information).
La loi DADVSI relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information du 1er août 2006, vise à harmoniser les droits français et européens. Elle définit en particulier une exception pédagogique concernant la reproduction ou la représentation d’œuvres (en particulier numériques) dans le cadre de l’enseignement. Des accords entre le ministère de l’éducation nationale et cinq organismes gestionnaires de droits ont été signés pour la période entre 2007 et 2009 (en échange d’une compensation financière). Un nouveau texte d’encadrement est paru début 2012.
Avant de reproduire ou diffuser une œuvre numérique il faut d’abord déterminer si elle est protégée par un droit d’auteur et les conditions d’usage octroyées par une éventuelle licence. On peut consulter les mentions légales ou les crédits, ou joindre le webmestre s’il s’agit d’une image provenant d’un site internet. L’absence de copyright ou de mention légale ne signifie pas qu’une œuvre n’est pas protégée. Par ailleurs, l’exception pédagogique peut dispenser de demande d’autorisation dans le cas d’une utilisation pédagogique sur le réseau intranet d’un établissement.
Licences logicielles
Une licence de logiciel est un contrat qui octroie un droit d’usage non exclusif et par lequel le titulaire des droits d’auteur du logiciel définit les conditions dans lesquelles ce programme peut être utilisé, diffusé ou modifié par l’usager.
Historique :
Dans les années 50 et 60, les ordinateurs étaient de gros calculateurs et l’informatique concernait principalement des spécialistes (ingénieurs, chercheurs). Les logiciels ou software existaient mais étaient indissociables de la machine sur laquelle ils étaient installés par le fabricant. L’interopérabilité des programmes, la normalisation des formats de données n’étaient pas dans l’air du temps. D’ailleurs, le constructeur ne facturait pas le logiciel qu’il livrait avec leur machine et fournissait les codes sources aux utilisateurs afin qu’ils puissent adapter les ressources de l’ordinateur à leur usage ou rectifier certains bugs. Dans les années 70, des projets de développement logiciels d’importance émergèrent comme le projet UNIX d’un système d’exploitation multiutilisateurs. Il fut d’abord développé par Ken Thompson et Denis Ritchie (créateur du langage C) dans les laboratoires Bell. Cette entreprise livra le code source à l’université de Berkeley dont les étudiants améliorèrent le projet qui fut distribué sous le nom de BSD (Berkeley Software Distribution).
À cette époque, les échanges de code sources entre développeurs étaient naturels et ils furent accélérés par le déploiement du réseau Arpanet d’interconnexion des universités et centres de recherche (l’ancêtre d’internet).
L’essor de la micro-informatique dans les années 80 et le changement de profil des usagers (plus forcément des spécialistes), firent du logiciel un facteur dominant du marché de l’informatique. Les sociétés d’édition de logiciels comme Microsoft se sont développées et ont proposés des solutions logicielles pour remplacer celles les concepteurs de machines, l’ergonomie de ces nouveaux logiciels a assuré leur succès. Cependant la protection du savoir-faire et du code devint un facteur essentiel de leur stratégie de développement. L’époque des pionniers de l’informatique qui partageaient leurs codes sources et leurs idées était révolue.
En 1984, Richard Stallman démissionna du MIT (Massachusetts Institute of Technology) , créa la Free Software Foundation (FSF) et lança le projet GNU de développement d’un système d’exploitation libre dont aucun élément ne serait soumis à une licence propriétaire (la première distribution Unix sans code propriétaire ne fut publiée qu’en 1989). Stallman créa la première licence logicielle libre : la General Public License (GPL). Le projet GNU aboutit en 1991 au système d’exploitation libre GNU/Linux après incorporation du dernier élément manquant, le noyau (ou kernel), apporté par Linus Torvalds.


Les licences logicielles:
On distingue:
- les licences propriétaires : un éditeur concède un droit d’usage sur un logiciel dont il conserve les droits de propriété intellectuelle. Un Contrat Licence Utilisateur Final (CLUF) délimite les conditions d’usage du logiciel : limitation du nombre de copies, de postes sur lequel le logiciel peut être installé, interdiction de modification et de redistribution. En général, le code source n’est pas accessible (on parle de logiciel fermé)...
- les licences libres ou open-source : elles respectent quatre libertés fondamentales du logiciel libre : liberté d’exécuter le programme pour tous les usages, liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de le modifier pour l’adapter à ses besoins, liberté de redistribuer des copies, liberté de redistribuer aux autres des copies de versions modifiées.
Attention de ne pas confondre logiciels libres (free en Anglais) et gratuits (free of charge), un freeware désigne usuellement un logiciel distribué gratuitement, indépendamment de sa licence d’utilisation. Le code source n’est pas forcément fourni ; dans ce cas ce n’est pas un logiciel libre.


On distingue deux types de licences libres :
- Les licences avec copyleft :
Le copyleft (« gauche d’auteur », jeu de mots sur copyright), n’est pas l’abandon du copyright (droits patrimoniaux) mais au contraire s’appuie dessus pour rendre libre un programme (respect des 4 libertés fondamentales) en obligeant toutes les versions modifiées à être libres également et redistribuées sous la même licence. Ainsi le logiciel (ou l’œuvre numérique) sera éternellement libre. La licence GPL créée par Richard Stallman en 1989 fut la première licence libre avec copyleft.

La licence CeCill est une adaptation de la licence GPL au droit français. La licence Creative Commons CC BY-SA 3.0, paternité et partage à l’identique, est une licence libre avec copyleft pour les œuvres numériques (image, vidéo...).
Il existe des formes plus ou moins fortes de copyleft. Ainsi si on inclut du code sous licence GPL dans un autre, le programme hybride créé « hérite » de la licence et doit être distribué sous licence GPL. La licence LGPL présente un copyleft plus faible : du code sous cette licence peut être inclue dans un code sous une autre licence sans que le programme hybride soit nécessairement sous licence LGPL. C’est utile pour développer des bibliothèques de fonctions.
- Les licences sans copyleft :
L’utilisateur peut redistribuer et modifier le logiciel, mais aussi ajouter des restrictions et distribuer une version modifiée sous licence propriétaire. On parle aussi de « licence permissive ». La première licence libre sans copyleft fut la licence BSD pour les distributions de logiciels créés par l’université de Berkeley.
La licence de Python est une licence libre sans copyleft. Ce sont des licences compatibles avec la GPL mais la réciproque est fausse.
Les licences pour contenus numériques autres que logiciels:
Les « Creative Commons » ont été développées afin d’appliquer les règles du logiciel libre aux créations numériques de toute nature (texte, vidéo, image, photo, musique ?). D’autres licences libres sont apparues en France (Licence musique libre, licence public multimédia, Art libre) pour la diffusion des œuvres sur internet mais les licences Creative Commons sont les plus connues.

Ce sont des contrats de cession non exclusive des droits patrimoniaux de l’auteur qui ont pour but d’adapter le régime des droits d’auteur afin de favoriser la diffusion et le partage des créations sur le réseau internet. En effet, ces licences (comme celles du logiciel libre) permettent d’accorder par avance aux utilisateurs des libertés non prévues par le droit d’auteur. Ainsi il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation de l’auteur si l’utilisation est permise par la licence. Les libertés accordées sont modulables selon 6 licences possibles.
Les conditions communes aux 6 licences sont les suivantes :
- la cession du droit de reproduire, de distribuer et de communiquer l’œuvre au public est consentie à titre non exclusif et à titre gratuit,
- la licence et les options choisies doivent apparaître à chaque utilisation ou diffusion,
- l’auteur peut donner son autorisation pour une utilisation non prévue par la licence initiale.
Les conditions optionnelles sont les suivantes :
- le droit à la paternité : l’œuvre peut être librement utilisée à condition de citer le nom de l’auteur (cette condition est optionnelle dans la version américaine mais pas dans la version française). En France il faut citer toujours sa source si elle est sous Creative Commons.
- L’utilisation commerciale et le droit de modification : l’auteur peut autoriser à l’avance les modifications mais les utilisations commerciales restent soumises à son autorisation ;
- le partage à l’identique : modifications autorisées mais obligation faite aux œuvres dérivées d’être distribuées avec les mêmes options de licence Creative Commons.
Conclusion sur les licences
Les licences libres ont permis un nouveau mode de développement des logiciels, par une démarche coopérative. Le système d’exploitation GNU/Linux est développé par des centaines de programmeurs du monde entier. L’ouverture du code source permet aux développeurs de faire évoluer plus rapidement le programme lorsqu’un bug est détecté. L’open source offre aussi une garantie aux états qui ne souhaitent pas dépendre entièrement de logiciels édités par des entreprises étrangères qui pourraient dissimuler des systèmes d’espionnage dans leur code. De plus l’interopérabilité des logiciels et des formats est une préoccupation constante dans le monde du libre alors que les éditeurs de logiciels propriétaires ont intérêt à réduire la portabilité en développant une stratégie d’exclusivité (compatibilité réduite entre formats Microsoft et format ouvert open document, stratégie d’Apple avec ses produits « fermés »).
L’essor du logiciel libre s’est traduit au cours des années 1990 et 2000 par l’apparition de fondations à but non lucratifs développant des projets devenus majeurs comme Mozilla/Firefox, Libreoffice, Gimp, etc.
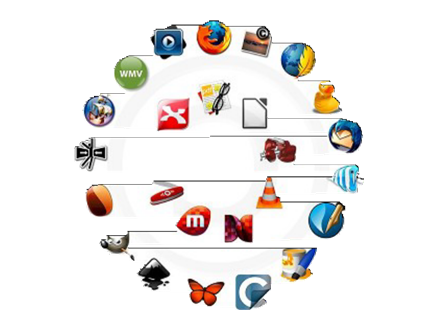
Les licences propriétaires ont permis à des sociétés informatiques de se développer et de proposer de nombreux emplois dans l’informatique : plus de 100 000 employés chez Microsoft et 116 000 chez Apple en 2016, etc..
Il est probablement nécessaire que les deux « mondes » coexistent dans l’intérêt économique de tous.
Supranationalité et perméabilité des réseaux
Certains pays se désintéressent de l'aspect légal des contenus numériques. Il est alors possible de mettre à disposition des plateformes de diffusion illégale via internet à partir de serveurs installés dans ces pays. Le réseau internet est dit supranational ( il est au dessus des nations), il permet en partie d'échapper aux lois des nations. Pour lutter contre la diffusion illégale d’œuvres numériques, les nations concernées ont mis en place des dispositifs de contrôles plus ou moins efficaces comme le blocage des adresses des serveurs connus pour héberger des contenus illégaux ou l'interdiction des VPN ( virtual private network) qui permettent des échanges cryptés via internet .
Le FBI a réussi à trouver une faille au réseau TOR qui a conduit à l'arrestation de nombreuses personnes aux Etats Unis et en Europe via Interpol.
Les réseaux posent d'autres problèmes que la violation des droits , notamment ceux liés à la sécurité informatique et au respect de la vie privée. Edward Snowden un ancien agent de la NSA a remis aux journalistes des documents prouvant que les Etats Unis ont espionné des chefs d'états européens et diverses grandes entreprises comme Airbus industries et Orange en France.
Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Produire facilement des livres électroniques Kindle